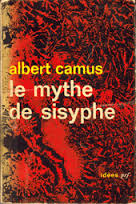
Wiki truc, wiki machin ou wiki chose, l’univers virtuel déborde d’outils sympas, cools et gratuits. Le préfixe wiki annonce la couleur : celle d’un bricolage original, indemne de cupidité, frontalement opposé à la rouerie mercantile des grands éditeurs. Le wiki se veut outil collaboratif. Cet adjectif très laid, tiré d’un jargon technocratique, désigne un travail réalisé en équipe. Ainsi Wikipédia s’annonce encyclopédie collaborative : chacun écrit ce qui lui passe par la tête sur les sujets les plus divers. Les articles sont modifiables par n’importe quel utilisateur d’internet. Et que se passe-t-il si vous écrivez des bêtises ? Eh bien, d’autres mieux informés s’emploieront à corriger.
Voilà le pari de l’affaire : la main invisible du savoir de masse est censée rejeter les outrages, décourager les vandales, écœurer les mauvais esprits pour recueillir in fine la substantifique moelle de l’antique sapience.
Joli programme. Le problème est que même si vous écrivez des choses exactes, d’autres se chargeront de les travestir ou les supprimer selon leur gré. Que vous soyez spécialiste du domaine ne change rien.
Car, voyez-vous, l’objet de Wikipédia n’est pas la véracité, mais la neutralité de point de vue.
Or, une encyclopédie où la vérité n’est pas le but n’est par définition pas une encyclopédie. C’est un recueil de racontars. Une encyclopédie fondée sur la neutralité est une contradiction dans les termes. L’impartialité n’est pas un gage de savoir ; et l’exactitude du savoir n’est jamais neutre.
Prétendre que la vérité est relative est un poncif éculé. La connaissance a précisément le but de cerner au mieux la réalité. Si tout est relatif, l’idiot et le savant sont au même niveau, chacun s’exprime selon ce qu’il a en tête, nulle légitimité ne prévaut. Préjugés et raison scientifique ? Rumeurs et faits historiques ? Raison et superstition ? Kif kif, tout cela, Wikipédia d’un ton fat étale tout, le vrai, le faux, l’idiot, le sublime et l’ignoble, mêle fange et chantilly, faits historiques et rumeurs people, axiomes et vilenies. Chaque point de vue, nous dit-on, est censé présenter un caractère pertinent. Alors, tout va bien ? Hélas non, car qui jugera de la pertinence des points de vue, sinon des anonymes dont la propre pertinence de jugement échappe à tout contrôle ?
Le principe rappelle les procédés où au nom de la sagesse populaire l’idiot du village était nommé chef à la place du chef. C’est le jour des fous médiéval ; mais sur Wikipédia, le village est planétaire, et chaque jour est jour des fous.
L’on mesure à quel point Wikipédia rassure l’âne et chagrine le savant. « Si t’es pas content, t’as qu’à corriger ». L’argument (soyons gentil) des wikipartisans tombe dans un vide sidéral. N’étant pas ignare en tout, je relève des erreurs manifestes dans un nombre considérable d’articles de la pseudo-encyclopédie. Mais n’étant pas savant en tout, je ne saurai gaspiller une part de mon existence à rechercher les informations exactes pour rectifier ces mêmes articles. Activité d’autant plus vaine que n’importe quel scribouillard de l’internet pourrait en une paire de clics annihiler mon travail au nom du principe que l’âne vaut le savant, déclenchant échange d’arguments à n’en plus finir, arbitrages et autres joyeusetés bureaucratiques dont la sympa Wikipédia regorge.
Mais surtout, activité vaine parce que ce travail existe déjà, réalisé par des gens qui savent : je parle ici des encyclopédies – les vraies – dont c’est précisément la fonction. Vouloir corriger Wikipédia renvoie pêle-mêle à deux personnages mythiques : Sisyphe et Augias.
Une encyclopédie n’est pas rédigée au gré du tout venant. Elle éclaire au lieu de noyer le lecteur. Elle présente l’essentiel avant l’accessoire, offre des articles construits selon une logique interne, et non constitués d’un invraisemblable bric à brac de brimborions entassés en un fatras chaotique selon le bon vouloir de rédacteurs à la sauvette.
Ils voulaient édifier le palais idéal du facteur Cheval, ils n’ont réussi qu’à construire un bidonville grotesque, chaque jour plus bedonnant et précaire.
Il existe, nous dit-on, quelques très bons articles sur Wikipédia. C’est l’argument du poissonnier qui, entre crevettes avariées et dorade picorée par les mouches, vanterait la fraîcheur d’un saint-pierre. Sur un million d’articles, qu’il surnage quelques textes dignes d’intérêt n’est à vrai dire pas étonnant. Encore faudrait-il aussi faire la part entre ce qui revient à Wikipédia et ce qui relève du plagiat dans cette masse infime.
L’anonymat sonne la revanche des médiocres, des frustrés, des révisionnistes, sectaires et tarés de tout poil, heureux de cette tribune prestigieuse et camouflée leur offrant une caisse de résonance sans égale. A l’abri de leur nouvelle respectabilité, les voilà dans la place pour insinuer leurs lubies, asséner leur pouvoir, dégoûter les plus savants qu’eux ayant l’heur de ne pas partager leurs manies. Certains domaines sont chasse gardée. D’où l’enjeu territorial jalousement veillé par des escrocs tout-puissants. Wiki, dada bobo tombé dans les griffes d’apprentis despotes.
Le droit à l’erreur justifie l’à peu près et le n’importe quoi ? Non. Toute production humaine est en soi entachée d’anomalies plus ou moins vénielles. Cela ne saurait justifier l’approche sciemment biaisée de l’information. Travestir délibérément la connaissance va à l’encontre même des principes qui fondent notre civilisation. Or ce dernier cas est exactement celui de Wikipédia, ouverte à tous les vents de la bêtise anonyme.
Par contagion, le terme wiki se retrouve dans une multitude de projets collaboratifs, souvent gratuits et se voulant en décalage avec une hypothétique « ligne officielle ». Être wiki, c’est être un rebelle, un sympathique bénévole empli d’humanisme et investi d’une mission dont il discute à longueur de temps les mérites en une sorte de novlangue qu’il partage avec ses pairs.
Récemment, un site nommé Wikileaks (version non censurable de Wikipédia, sans lien avec celle-ci) a publié sur la toile mondiale un gros paquet de documents confidentiels sur la guerre en Afghanistan, sans masquer le nom des informateurs opposés aux Talibans. Quelles que soient les opinions que l’on possède au sujet du conflit, quel que soit son avis sur l'à-propos de mettre à disposition du public des informations classées top secret, il faudrait avoir un cœur de pierre pour admettre sans broncher le péril mortel qu’une telle initiative fait peser sur la tête des soutiens locaux des démocraties.
Merci qui ? Merci wiki !